Graphique 1 : parts des différents émetteurs sur le marché, 1919-1936
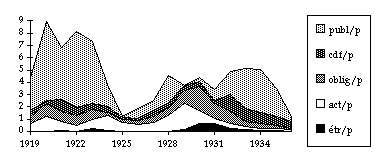
Environnement macro-économique, transformations du système financier
et financement des
entreprises durant l'entre-deux-guerres en France
Pierre-Cyrille Hautcœur (École normale supérieure)
Article paru dans Économies
et Sociétés, série A.F., 22, 4-5/1996, pp.293-315.
English title : macro-economic environment, financing system and the financing of private firms in interwar France.
Résumé : La première guerre mondiale transforme profondément le système financier français : la hausse de la dette publique et la modification des relations financières avec l’étranger conduisent à la création de nouvelles relations entre les intermédiaires financiers. Ce nouveau système financier se caractérise paradoxalement à la fois par un haut niveau de financement de marché des entreprises privées et par un rôle essentiel des banques. Il est cependant instable et disparaît après la stabilisation du franc, avant même le début de la dépression.
English summary
: The first world war transforms completely the french financing system
: public debt rises, financial relationships with foreign countries fall
and change, and the consequences of these transformations on the interrelations
between all financial intermediaries create a new system caracterised by
a high level of market finance of private firms and by a great power of
the banks. This system is unstable, and it begins to disappear from the
stabilization of the franc, before the effects of the great depression.
Environnement macro-économique, transformations du système financier
et financement des entreprises durant l'entre-deux-guerres en France
Cette article présente une tentative de synthèse sur le fonctionnement du marché financier français dans l'entre-deux-guerres. La lecture habituelle de l'histoire financière de cette période montre un marché financier entièrement préempté par l'État dans l'immédiat après-guerre, puis une multiplication des émissions privées durant une très brève période d'euphorie s'achevant en une bulle financière dont l'éclatement inaugure la crise des années 1930. Les critiques de cette lecture insistent sur le dynamisme économique résultant du maintien de taux d'intérêt relativement bas (parfois négatifs en termes réels) durant la période d'inflation. Ces taux bas résulteraient d'une adaptation lente des anticipations à une création monétaire abondante et d'un choix keynésien en faveur de l'économie nationale passant en particulier par l'interdiction des exportations de capitaux. Ces deux perspectives minorent le rôle du marché financier dans le financement des entreprises privées, rôle qui est considérable durant les années 1920, exagèrent l'illusion monétaire et négligent largement le fonctionnement du système financier (en l'assimilant un peu vite à celui qui dominera après 1945).
La thèse que nous défendons est la suivante : la guerre entraîne une transformation complète du système financier qui ne peut être comprise que si on l'étudie dans son ensemble, en intégrant le rôle des intermédiaires financiers (banques, agents de change et coulissiers) et les changements de l'offre et de la demande de titres. Alors que le système financier était avant 1914 centré sur la Bourse et en particulier sur le marché de la rente publique, des obligations quasi-publiques et des titres étrangers, la guerre le bouleverse. La dette publique et les relations financières avec l'étranger, prises en main par les banques, quittent pour une large part l'enceinte de la Bourse, qui va reporter son activité sur les entreprises privées.
Après avoir rappelé l'importance que prend dans les années 1920 le marché financier dans le financement des entreprises françaises, on cherchera à montrer comment les émissions de l'État et les prêts à l'étranger ont coexisté avec cette demande nouvelle, et en particulier comment l'ensemble du système financier s'est modifié en un sens qui devait s'avérer favorable au développement des émissions de titres des entreprises privées. Enfin, on montrera pourquoi cette situation constituait un équilibre précaire qui ne pouvait pas survivre à la disparition des circonstances particulières qui l'avaient fait naître.
L'augmentation des besoins de financement externe des entreprises
Grâce à la réunion de données nouvelles sur les entreprises cotées en Bourse de Paris, nous avons montré récemment (Hautcoeur, 1993a) que le marché financier prenait durant l'entre-deux-guerres et en particulier durant les années 1920 une importance beaucoup plus grande qu'auparavant dans le financement des entreprises françaises. La part des émissions de titres passe en effet de 22% en moyenne pour les sociétés présentes à la cote officielle entre 1901 et 1913 à 39% entre 1913 et 1928 (elle serait encore plus élevée sur 1918-1929, car la guerre voir l'arrêt des émissions) ; la part des actions atteint 23% et celle des obligations 16% (soit un doublement pour les premières et une hausse de 50% pour les secondes).
Cette évolution est d'autant plus importante qu'elle s'étend aux secteurs industriels qui n'avaient avant 1914 qu'un accès très limité au marché financier (ainsi, pour les industries de biens intermédiaires, le financement de marché passe de 7% à 20% du total et pour celles de biens de consommation de 13% à 33%), et qu'elle s'accompagne d'une augmentation rapide du nombre des entreprises cotées, qui passe de 372 fin 1913 (dont 207 sociétés industrielles) à 672 fin 1929 (dont 445 industrielles). Le financement par émissions de titres devient ainsi accessible à nombre d'entreprises industrielles de taille moyenne.
Cette évolution s'explique difficilement par les facteurs habituellement mis en avant par la théorie micro-économique, puisque la fiscalité qui frappe le recours au financement externe augmente fortement après 1918, qu'elle frappe davantage les actions que les obligations (alors que la part des premières dans le financement augmente fortement), tandis que les asymétries d'information entre dirigeants des entreprises et épargnants, et les divers coûts de mandat qui en résultent et devraient freiner le financement de marché, ne connaissent pas davantage de baisse (sur ces points, cf. Hautcoeur, 1994, chap. 4 et 5).
La raison majeure de l'augmentation des émissions de titres des entreprises semble donc l'augmentation de leurs besoins de financement externe dans une période où l'autofinancement est insuffisant par rapport aux besoins de la reconstruction puis à ceux d'un investissement en forte croissance. En particulier, l'impôt sur les bénéfices de guerre, le récent impôt sur les bénéfices et la hausse des impôts sur les revenus du capital frappent sensiblement la capacité d'autofinancement des entreprises.
Nous constatons a posteriori l'importance des émissions des entreprises privées sur le marché. Pourtant, la possibilité de recourir à ce financement n'était en rien évidente a priori. En effet, non seulement le marché financier accueillait avant 1914 peu de sociétés privées, surtout industrielles, mais la demande pour leurs titres était faible dans un public accoutumé aux titres publics (français ou étrangers), tandis que les intermédiaires financiers étaient beaucoup plus adaptés à l'organisation (pour les banques d'affaires) et au placement (pour les banques de dépôt) de grandes émissions publiques qu'à celles de valeurs industrielles. Nous devons donc chercher à expliquer à la fois pourquoi les anciens émetteurs dominants ont laissé les entreprises privées prendre une place importante sur le marché financier, et comment le système financier s'est transformé pour leur fournir efficacement les capitaux nécessaires.
Les effets contrastés de l'endettement public
La guerre provoque une augmentation considérable de la dette publique, d'autant plus difficile à supporter que son niveau initial était important du fait de l'absence d'efforts sérieux pour la réduire à la fin du XIXe siècle. À son niveau de 1919 (1,88 fois le PIB contre 0,63 en 1914, et ce malgré une première dévalorisation par une inflation qui atteint déjà 150% par rapport à 1913), cette dette est difficilement supportable, d'autant que sa pression a fait monter les taux d'intérêt, de sorte que les intérêts à verser représentent une part considérable du budget (plus de 45% des recettes ordinaires et 7,4% du PIB en 1921). Si on ajoute à ces paiements les dépenses qui incombent à l'État du fait de la reconstruction et des pensions de guerre, on ne peut s'étonner de voir les émissions publiques accaparer après la guerre les fonds offerts sur le marché financier (graphique 1).
Cependant, en dehors de la disparition complète des émissions étrangères, les autres emprunteurs maintiennent leurs émissions : celles des sociétés privées retrouvent dès le lendemain de la fin de la guerre leur niveau réel des années d'euphorie qui l'avaient précédée. Le marché des capitaux à long terme parvient ainsi à un degré de développement exceptionnel, les émissions totales frôlant les 9 milliards de francs 1913 en 1920 (contre un record avant guerre de 4,75 milliards en 1910), soit 22,6% du PIB (contre 10,1 en 1910). Même si l'effort d'épargne est réel, résultant à la fois du souci de reconstitution d'un patrimoine matériel détruit par la guerre, d'une épargne financière réduite par l'inflation, et de la pénurie sur le marché des biens, il est clair que l'épargne forcée par l'inflation contribue pour beaucoup à ces montants (1920 voit d'ailleurs un taux d'inflation record de près de 38%).
Cependant si jusqu'à 1920 c'est en grande partie par l'émission monétaire que l'État a assuré le placement de sa dette, ce n'est plus le cas après. De 1920 à 1923, la fuite devant la monnaie est évitée grâce à un ralentissement de la création monétaire. Malheureusement, la répartition de la charge de la dette par l'impôt suscitant des débats insolubles, la dette à court terme augmente. De ce fait, après 1923 la confiance fait défaut aux émissions publiques, et la fuite devant la monnaie reprend, entraînant également une chute des émissions privées. On ne peut donc pas parler entre 1918 et 1926 de variations antagonistes mais plutôt parallèles des émissions publiques et privées, les variations des unes comme des autres étant déterminées principalement par la situation macro-économique et la confiance des détenteurs de capitaux dans la capacité des gouvernements à juguler l'inflation. Ce n'est qu'au sein des émissions privées que cette même situation impose un transfert des obligations vers les actions, mieux à même de protéger leurs détenteurs de la dépréciation de la monnaie.
À partir de 1926, la situation s'inverse : l'État, dont la situation financière est restaurée (réforme fiscale, reprise économique et surtout dévalorisation de la dette par l'inflation aidant) consolide la dette flottante puis cesse d'émettre, tandis que les émissions privées se développent à un degré jamais atteint. L'abstention de l'État aide clairement, comme avant 1914, à ce développement, par la baisse rapide des taux d'intérêt qu'elle favorise comme par les versements considérables de coupons et les remboursements qu'il effectue.
Les relations financières avec l'étranger
La guerre provoque une réduction massive des avoirs sur l'étranger et un endettement important auprès du Royaume-Uni et des États-Unis, ce qui, avec la détérioration de la balance commerciale et la hausse des prix, est à l'origine de la chute du taux de change du franc dès sa libération au début de 1919. Selon l'interprétation keynésienne traditionnelle, la restriction des exportations de capitaux fait partie, avec le développement d'un système bancaire public et parapublic, des mesures qui expliquent le dynamisme de la croissance des années 1920. Cette lecture néglige cependant les effets pervers de ces restrictions sur le fonctionnement et sur la stabilité du système financier.
En réalité en effet, ces restrictions sont inutiles dès 1921, car les conséquences monétaires et financières de la Grande guerre au niveau extérieur sont alors déjà achevées. L'ajustement de la parité du franc est en effet terminé dès les premiers mois de 1920, après une division par trois de sa valeur en un an. Les années 1920 à 1923 sont marquées par une forte instabilité du taux de change, mais sans tendance à une dévalorisation supplémentaire. Dans ce contexte, où nombre de spécialistes anticipent une revalorisation du franc, nulle interdiction n'est nécessaire pour décourager les émetteurs, d'autant que l'incertitude sur le sort de nombre de créances d'avant-guerre rend frileux des épargnants qui accueillent froidement les rares emprunts lancés en France pour des raisons diplomatiques. L'interdiction des émissions étrangères semble donc dans un premier temps largement superflue.
Après 1921, aucune raison macro-économique ne justifie plus le maintien de contraintes importantes sur ces émissions. En effet, la balance courante se rétablit rapidement, et dégage rapidement des excédents substantiels, en particulier du fait de l'afflux des réparations allemandes (Rist & Schwob, 1939, Lévy-Leboyer, 1977, p.135). À l'équilibre, cet excédent correspond à une économie française qui consent des crédits à court terme importants au reste du monde. Les sorties d'or qui, durant une part importante des années 1920, s'ajoutent à l'excédent des paiements courants, témoignent également de sorties de capitaux. Ces prêts à l'étranger sont réalisés à la fois par le non-rapatriement de paiements d'exportations et par l'achat de titres étrangers non cotés à Paris, toutes opérations dans le bon fonctionnement desquelles le système bancaire joue sans doute un rôle essentiel.
On a tout lieu de penser que les exportations de capitaux exercent un effet d'éviction sur le financement des entreprises françaises, en particulier entre 1924 et 1926. Les efforts des gouvernements pour restreindre les achats et les échanges de titres et de créances étrangers n'empêchent pas le développement de ces pratiques, auxquelles seul un contrôle des changes beaucoup plus strict pourrait faire obstacle. Ils prouvent au contraire leur développement. Pire, en multipliant les interdictions, en rehaussant les taxes sur les titres étrangers non abonnés, en interdisant même à la coulisse de les négocier, l'État augmente la fraude, les inégalités entre épargnants, et incite au placement à court terme, le moins repérable et le plus déstabilisateur.
L'interdiction des émissions étrangères n'a donc pas empêché les placements extérieurs ; étant donné les montants estimés pour les excédents de capitaux, il est même probable qu'elle ne les a pas freinés, mais les a rendu instables. Dominés par un petit nombre d'acteurs (essentiellement les grands capitalistes et les grandes banques) très sensibles à la situation budgétaire et fiscale, ces placements sont au cœur de la chute du franc de 1924-1926 et des difficultés rencontrées pour consolider la dette flottante et limiter l'inflation.
La reprise des émissions étrangères à la veille de la crise ne permet pas au marché parisien de retrouver son activité d'avant-guerre. En effet, la situation du marché financier est encore soumise aux flux de capitaux à court terme, désormais dirigés vers la France ; si les exportations de capitaux à long terme reposent entre 1927 et 1929 (voire 1930) sur un solide excédent courant (quoique dépendant des réparations), elles ne se poursuivent en 1931 et 1932 que grâce à des entrées (ou rapatriements) de capitaux à court terme attirés par un pays que la crise semble épargner. À l'inverse de ce qui se passait au XIXe siècle, l'essentiel des relations financières internationales de la France se déroule ainsi durant tout l'entre-deux-guerres loin du marché des capitaux à long terme et en particulier de la Bourse, ce qui fragilise la balance des paiements française.
On est ainsi amené à nuancer fortement l'image traditionnelle selon laquelle la fin des émissions étrangères aurait automatiquement facilité le financement de l'État et des entreprises tandis que les déficits publics auraient évincé les entreprises du marché. En réalité, les exportations de capitaux reprennent rapidement, tandis que l'État emprunte massivement sans évincer les entreprises grâce à la création monétaire. Les besoins des entreprises privées ne sont dans ce contexte satisfaits que grâce à l'inflation et parce que les évolutions de la situation financière de l'État et de la balance des paiements ont des effets importants sur la structure du système financier. Nous examinons maintenant les transformations de ce dernier.
Le rôle central des banques et le recul du marché boursier
Au delà du seul marché financier, c'est l'ensemble du système financier français qui est mobilisé au lendemain de la guerre pour subvenir aux besoins de l'État. Certes, la dette à long terme est d'abord souscrite par des particuliers et par des compagnies d'assurance, mais ceux-ci deviennent de plus en plus réticents devant les titres à revenu fixe du fait de l'inflation. La part de la Caisse des dépôts dans la dette publique, considérable avant 1914, a faibli avec les ressources de cet organisme durant la guerre. Malgré ses efforts, l'État est donc dans l'incapacité de réduire la dette flottante constituée durant l'immédiat après-guerre.
Or cette dette à court terme (près de 85% du PIB en 1919, plus de 30% de l'ensemble de la dette publique jusqu'à 1926 inclus) est largement détenue par les banques, à l'actif desquelles elle qui se substitue aux effets de commerce jusqu'à la stabilisation du franc (Bouvier, 1980, p.708, Dauphin-Meunier, 1936, p.130, Laufenburger, 1940, II, p.64ss et Pose, 1942).
L'augmentation de la dette flottante et la disparition des émissions étrangères à long terme comme moyen d'équilibrer la balance des paiements ont pour effet de transformer les rapports entre le système bancaire et le marché boursier. On a vu qu'en l'absence d'émissions de titres, les exportations de capitaux se font par des biais multiples, au noeud desquels se trouvent les banques. De même, la détention de montants importants de bons du Trésor par celles-ci, combinée avec la dépréciation du franc entraîne un changement d'axe du système financier français. Le lieu principal où se déterminent les taux d'intérêt et où est assuré le maintien de la liquidité à court terme n'est plus la Bourse et le marché à terme sur la dette publique qui y régnait avant 1914, mais le marché des capitaux interbancaires à court terme (Bouvier, 1984 et Bouvier & al., 1980).
Avant 1914, le marché à terme organisé par la coulisse de la rente assurait une forte liquidité à la dette publique et déterminait les conditions du crédit pour toute la place. Disparu du fait de la guerre, interdit par la suite jusqu'à 1921, ce marché ne reprend que lentement et ne retrouve pas son activité antérieure (en témoigne par exemple la baisse de 90% en termes réels des montants placés par les banques sur les reports). En l'absence d'un marché à terme sur la rente pour placer les disponibilités à court terme, et d'un vaste marché des titres étrangers permettant l'ajustement en souplesse de la balance des paiements, les banques ont appris à opérer sur des actifs à court terme non directement commerciaux, et créé de nouveaux marchés qui font obstacle à la renaissance du marché boursier.
Le développement de ces opérations essentiellement interbancaires résulte également de la raréfaction par rapport à l'avant guerre des ressources normales des banques. Devant la concurrence des nouveaux intermédiaires financiers publics sur les dépôts, et les relations tendues avec la Banque de France qui développe son escompte direct, les banques se sont organisées pour s'assurer mutuellement la liquidité nécessaire sans passer par l'escompte de la banque centrale. Enfin, le développement de leurs opérations sur le marché des changes découle de l'apparition d'un risque de change, source potentielle pour les banques de profits élevés pouvant remplacer les "grandes affaires" d'avant-guerre (émissions étrangères et financement du négoce international en particulier), au prix d'un risque élevé mais largement invisible.
L'existence d'une dette flottante importante détenue par les banques met donc celles-ci au centre du système financier, par opposition à la domination du marché de la rente avant 1914. L'interdiction des émissions étrangères à long terme au profit d'opérations sur les marchés étrangers réalisées principalement par les banques a le même effet. Il en résulte une instabilité plus grande de la capacité d'endettement de l'État comme du marché des changes, et un affaiblissement considérable du marché boursier.
Symétriquement à cette position centrale des banques (contrastant d'ailleurs singulièrement avec l'affaiblissement de leurs ressources), on constate en effet un recul considérable du marché boursier. On a vu que le marché à terme de la rente qu'animait la coulisse n'a pas retrouvé son activité d'avant-guerre. Il en est pratiquement de même du marché des titres étrangers, en coulisse comme au parquet. La raison en est dans l'appauvrissement de la cote par la perte des créances sur le reste du monde, perte très supérieure à ce que semble indiquer la baisse, pourtant déjà massive, de la capitalisation boursière des titres étrangers cotés (de 70,8 milliards en 1913 à 47 en 1921, soit environ 13,4 milliards de francs 1913). En effet, la Bourse réagit avec retard et maintient à la cote durablement de nombreux titres dont la détention par des français a fortement diminué. La chute des transactions pendant la guerre, et le fait que, malgré une forte reprise après 1921, leur montant total reste très inférieur durant toutes les années 1920 à celui de 1913, sont les signes principaux de l'affaiblissement de ces deux marchés (Hautcoeur, 1994, ch.6).
Cette baisse frappe durement agents de change comme coulissiers. En effet, les opérations sur la rente (surtout les prises de position à terme) représentaient un revenu essentiel pour la coulisse, tandis que les agents de change, peu présents sur le marché de la rente, dépendaient largement des opérations sur les valeurs étrangères, qui représentaient en 1906 les deux tiers environ des transactions du parquet. Les hausses de courtages que les agents de change obtiennent des pouvoirs publics à l'occasion de la guerre ne compensent pas ces pertes, de sorte qu'agents de change comme coulissiers vont chercher à stimuler la reprise de l'activité durant les années 1920, y compris au détriment de la sécurité des placements de leurs clients.
Le développement du marché des titres privés
Malgré le contexte macro-économique radicalement bouleversé que nous avons décrit et les changements importants dans les rapports des différents éléments du système financier qui en découlent, nous avons vu que les entreprises privées accèdent après 1918 plus facilement qu'auparavant au marché financier. Pour comprendre cette évolution, nous étudions ci-dessous l'impact direct et indirect des changements en question sur ce segment du marché à travers l'examen de ses acteurs : épargnants, banques, agents de change et coulissiers, et entreprises.
Inflation et changement de comportement du public
La fuite devant la monnaie pousse les épargnants à se tourner vers les actions (Laufenburger, 1940, I, p. 162). Cette fuite s'étend à une large population comme en témoigne la faiblesse des dépôts à vue dans les banques jusqu'à la stabilisation. L'absence d'autres placements réels (les loyers et les baux agricoles sont bloqués) renforce l'attrait des actions.
Il semble en outre que la guerre ait réduit la puissance financière de la catégorie des gros porteurs d'avant 1914 (Dauphin-Meunier, 1936, p. 122). La saturation de la Bourse, les retards de livraison de titres et la multiplication des conflits entre confrères liés à l'engorgement des procédures de règlement témoignent de l'augmentation du nombre de détenteurs d'actions, d'autant que, on l'a vu, l'activité du marché n'a pas augmenté par rapport à l'avant guerre.
L'accès à la cote des sociétés privées : le rôle des banques
Le développement des besoins à long terme des entreprises se heurte à des banques (y compris les banques d'affaires) incapables de les satisfaire directement par des prises de participation ou des crédits à long terme, du fait de la baisse de leurs ressources réelles totales et de leur engagement dans le financement du Trésor. L'organisation systématique d'émissions sur le marché est la seule solution, et elle est poussée, grâce à l'élargissement du public intéressé et à la concentration industrielle, bien au delà des grandes sociétés auxquelles elle était réservée avant-guerre (Baldy, 1922, p. 201 ; Rebotier, 1935, p. 231).
Cependant, ce développement ne consiste pas en une simple croissance homothétique par rapport à l'avant-guerre, mais entraîne des modifications des rôles des différents éléments du système bancaire. Tout d'abord, le rôle des banques de dépôt se développe. Elles seules sont en effet capables de s'adresser à la clientèle agrandie des titres privés. Elles deviennent donc indispensables au placement des émissions importantes, dont elles évincent banques d'affaires et coulissiers (Dauphin-Meunier, 1936, p.66s, Pose, 1942, I, p.338s et 1939, p.336). Dès lors, elles peuvent imposer des procédures d'émission qui leur réservent l'essentiel des profits, en particulier la procédure de prise ferme, qui requiert des capitaux trop importants pour être accessible aux banques d'affaires ou aux coulissiers (Ducros, 1952, p.90s, Rebotier, 1935, p.169, Nakayama, 1982, p.70-81).
Ces dernières sortent plus affaiblies de la guerre que les banques de dépôts, à la fois du fait du recul de leur activité étrangère et de celui de leurs ressources. Tout en continuant d'assurer dans nombre de cas l'organisation des émissions des grandes sociétés (le placement étant confié aux banques de dépôt), elles se reportent vers l'introduction en Bourse et le développement d'entreprises plus petites. Elles emploient ainsi leur compétence d'analyse financière sans craindre la concurrence des banques de dépôt dont les réseaux sont inutiles pour les petits placements. Mais pour maintenir leur profit avec de telles opérations, les banques d'affaires doivent démarcher intensivement les sociétés potentiellement intéressées, pour multiplier les opérations financières diverses. Ceci explique, avec les besoins financiers des sociétés, la multiplication des admissions en Bourse (Cauboue, 1942, p.243), et le fait que le nombre moyen d'opérations touchant le capital-actions réalisées par les seules sociétés cotées (augmentations de capital en numéraire ou en rémunération d'apports, distribution d'actions gratuites, remboursements d'actions) passe de 0,075 par an et par société cotée entre 1890 et 1914 à 0,24 entre 1918 à 1929.
Cotations et émissions : le rôle des intermédiaires
De même que les particuliers ou les banques, les agents de change et les coulissiers sont d'abord incités à développer le marché boursier par leur intérêt personnel, et d'abord par la baisse de revenu que nous avons constatée plus haut. Celle-ci amène peu à peu les agents de change eux-mêmes à mettre de côté leur traditionnelle prudence. De la convergence de tous ces intérêts résulte une multiplication des admissions aux différentes cotes. Ainsi, les admissions à la cote officielle parisienne atteignent des niveaux très élevés, non seulement en nombre absolu mais même en taux de croissance du nombre de sociétés cotées (graphique 2). Le fait que les maximaux soient atteints en 1923-1924 autant que durant les années euphoriques 1928-1929 confirme le lien entre fuite devant la monnaie et demande d'actions (d'autant plus que la hausse des cours est plus élevée en 1927-28).
Les deux plus importantes Bourses de province (Lille et Lyon) connaissent aussi un développement rapide durant les années 1920 (François-Marsal, 1931), en partie grâce à un effort d'élargissement du public passant par une réduction des prix individuel des titres. Enfin, la coulisse se développe également rapidement, autant au moins que les indicateurs disponibles permettent de le mesurer (tableau 1). En 1924, elle crée un groupe hors-cote tant la conjoncture est jugée bonne, et cette expérience n'est suspendue en 1927 qu'à la demande du Ministère des finances qui la juge trop spéculative. D'ailleurs, les demandes émanant de sociétés désireuses de faire inscrire leurs titres en coulisse se multiplient, atteignant entre 1926 et 1928 successivement 129, 214 et 282 . Le nombre effectif d'inscriptions n'est pas connu, mais la variation du nombre de sociétés cotées et leur renouvellement entre le début et la fin des années 1920 montrent clairement un mouvement très dynamique des admissions (tableau 2).
La coulisse semble cependant épuiser sa capacité à se renouveler. Le rythme d'admission y diminue par rapport au début du siècle relativement à celui du parquet. Avec l'aggravation dans les années 1920 des disparitions de sociétés de sa cote (traditionnellement nombreuses), la coulisse est victime de la concurrence du parquet, auquel la croissance du public intéressé par les actions permet d'accueillir davantage de titres. Au moins une quinzaine de sociétés cotées en coulisse sont captées par la cote officielle dans les années 1920, ce qui représente la proportion la plus importante depuis les années 1890. Surtout, cette concurrence impose à la coulisse de "recruter" des entreprises plus petites et risquées qu'auparavant, au fur et à mesure de la diminution des exigences de la cote officielle.
Certes, la Compagnie des agents de change rejette avec constance, dans un souci de crédibilité, les accusations de manque de prudence. Elle affirme en particulier consacrer tous ses efforts au bon déroulement des introductions à la cote. Ainsi, selon Cauboué (1942, p.256s), le nombre de titres qu'une société dont le capital compte 100.000 actions se voit obligée de mettre à la disposition du marché lors de son introduction varie entre 1500 en période de récession et 10.000 dans un marché spéculatif, ce à quoi s'ajoute l'exigence d'un délai de trois ans écoulé depuis la fondation de la société (au moins pour les petites entreprises), et un capital minimal de 5 millions de francs.
Ces conditions semblent cependant surtout indicatives ; elles sont en effet de plus en plus fréquemment enfreintes, ce alors même que la condition de capital minimal est de moins en moins sévère du fait de l'inflation. L'évolution par rapport aux périodes antérieures de la taille moyenne des sociétés lors de leur admission à la cote indique également que les années 1920 voient la sévérité diminuer. Cette politique commerciale plutôt agressive du parquet est confirmée par la répartition sectorielle de ses admissions à la cote relativement à celles de la coulisse. Alors que le parquet était traditionnellement spécialisé dans les secteurs concentrés (transports ferroviaires et maritimes, banque et assurance, industries lourdes), il empiète de plus en plus sur les secteurs traditionnellement dominés par la coulisse (métallurgie légère, chimie fine, matériel électrique, automobile, alimentation). Une évolution domine les autres : l'augmentation de la spécialisation (ou du cantonnement ?) de la coulisse dans le secteur de biens de consommation, qui représente une part croissante de ses cotations et est le seul où elle fasse réellement jeu égal avec le parquet. Évincée partiellement de ses activités traditionnelles, celle-ci ne parviendrait à survivre que par des admissions de plus en plus nombreuses et spéculatives de sociétés probablement très petites cantonnés dans des secteurs relativement risqués. Cette fuite en avant ne permet d'ailleurs pas à la coulisse de stabiliser sa situation ; en 1929, année qui devrait lui être favorable puisque la spéculation y est importante, la coulisse ne réalise même plus la moitié des recettes du parquet à l'impôt sur les opérations de Bourse.
On peut conclure que durant les années 1920, la plupart des acteurs du marché financier, des épargnants aux agents de change, en passant par les entreprises et surtout les banques, voient converger leurs intérêts dans une multiplication des cotations et des opérations financières des sociétés françaises. Cette convergence dépend cependant de l'élargissement de la clientèle de ce marché, ainsi que probablement de la hausse des cours des actions. Ce développement du marché semble se poursuivre après la stabilisation du franc, bien que les banques voient leurs capacités de crédit augmenter fortement et que les besoins de financement des entreprises se reportent alors vers le crédit à court terme. En fait, nous chercherons à montrer ci-dessous que même sur le marché riche de liquidité des années 1928-29 (les rapatriements de capitaux du fait de la stabilisation sont importants, et la balance des paiements nettement excédentaire), ce développement s'appuie davantage sur les efforts des banques et des entreprises que sur le maintien du soutien du grand nombre des épargnants, qui souhaite un retour à une situation plus stable. Si les articles de journaux se multiplient signalant la sous-évaluation des actions en valeur-or, il faut y voir le besoin des banques et des intermédiaires divers de stimuler une hausse moins spontanée, qui ne correspond plus aux caractères fondamentaux de l'économie.
Crise et affaissement du marché des titres privés
La crise des années 1930 est considérée par nombre de contemporains hostiles au libéralisme comme la preuve du besoin de changer ou au moins d'amender sérieusement le système économique, en particulier dans sa composante financière. Dès 1936, les premières nationalisations tenteront de mettre l'économie à l'abri des soubresauts de la "sphère financière". Certes, l'évolution du marché dans les années 1920 peut probablement donner lieu à l'accusation de spéculation accrue. Nous chercherons cependant à montrer ci-dessous que si des pratiques spéculatives ont bien existé, la rupture du développement du marché financier après 1929 ne résulte pas de l'éclatement d'une bulle spéculative mais de la disparition des circonstances particulières qui avaient amené l'exceptionnelle croissance antérieure.
La croissance des années 1920 est-elle une bulle spéculative ?
Les contemporains ont souvent parlé de spéculation pour décrire le marché des actions des années 1920. Ce qualificatif résulte largement de l'apparition sur le marché d'une clientèle nouvelle et de l'importance prise par les gains en plus-value dans un monde inflationniste. Peut-on pour autant parler d'une spéculation différente du comportement normal des agents sur le marché des actions ? Il faudrait pour cela prouver que l'instabilité du marché s'est accrue, voire qu'apparaît une bulle spéculative.
Plusieurs arguments plaident en faveur de l'idée d'une instabilité accrue par rapport à l'avant-guerre. Ainsi, la variabilité de l'indice des cours s'accroît fortement (le coefficient de variation sur données annuelles est multiplié par 4 ou 5 entre 1890-1913 et 1918-1939 selon que l'on prend les indices bruts ou déflatés par l'indice des prix), comme celle du rendement par dividende des actions (le même coefficient passe de 8 à 14,5% d'une période à l'autre). Des données mensuelles limitées à 1929 montrent également la forte variabilité intra-annuelle des transactions. D'ailleurs, si l'ensemble des transactions du marché ne rattrape pas en 1929 son niveau de 1913, celles qui touchent les titres privés semblent augmenter considérablement.
Cependant, un calcul approximatif montre que le taux de roulement des titres privés (transactions rapportées à la capitalisation) n'est certainement pas supérieur à 2, soit un ordre de grandeur similaire à celui que l'on peut estimer pour 1906. Surtout, il ne semble pas que cette instabilité ou ces transactions en croissance rapide entraînent les cours à des niveaux exagérés. L'indice général des cours des actions ne dépasse pas les niveaux réels d'avant-guerre, et leur rendement par dividende n'atteint jamais de niveaux ridiculement bas (2,7% au minimum de 1929). De même, le rapport des indices de cours et de dividende reste durant l'ensemble des années 1920 inférieur à sa valeur de 1913 dans tous les secteurs à l'exception des banques. Il est donc difficile d'affirmer que les cours se soient substantiellement séparés de la valeur réelle des entreprises. L'absence de forte chute des cours au début de la crise va dans le même sens, car les bulles spéculatives finissent ordinairement par un krach comme celui de Wall Street en octobre 1929. À Paris, l'indice général ne baisse jamais de plus de 7% en un mois avant septembre 1931 (où il perd 11,5% du fait de la dévaluation de la livre sterling), et connaît en moyenne un rythme à la baisse plus lent que n'a été celui de la hausse en 1928.
L'explication de la conjonction d'une forte instabilité et de l'absence de bulle spéculative se trouve dans l'inflation : celle-ci justifie une hausse permanente des cours, qui stimule la diffusion des comportements spéculatifs sans conduire nécessairement à des débordements.
L'affaissement du marché des titres privés
Le retournement du marché ne résulte donc pas de l'éclatement d'une bulle spéculative, mais plutôt de la disparition de l'ensemble des causes qui avaient provoqué son développement dans les années 1920. De la guerre à 1928, le marché parisien a connu une hausse des cours quasi-permanente. Cette hausse suit d'abord d'assez loin l'inflation, puis s'accélère entre 1926 et 1928 grâce aux entrées massives de capitaux et à l'euphorie financière qui suit la stabilisation de fait du franc. Les différents intermédiaires financiers savent soutenir la hausse en fournissant des titres nouveaux, évitant peut-être une bulle spéculative. Cependant, alors même que le marché connaît ses maxima d'émissions et de cours, les éléments qui ont permis son développement durant les années 1920 s’effacent. La crise économique, tardive en France, ne fait alors que renforcer un affaiblissement du marché des actions déjà bien entamé.
Le retournement du marché financier commence dès 1928, avant même le sommet des cours, bien avant celui des émissions. Dès janvier 1929, les coulissiers accusent la stabilisation d'avoir mis fin à la spéculation et d'avoir par là affaibli le marché. Notre explication est la suivante : les nombreux nouveaux détenteurs d'actions des années 1920 ne l'étaient devenus que pour se protéger contre l'inflation. Dès la stabilité de la monnaie retrouvée et garantie par l'attachement à l'or, ils retrouvent leur préférence pour les titres à revenu fixe. De fait, les rendements exigés des obligations baissent fortement dès 1928, et des placements massifs d'obligations ont lieu de 1929 à 1931 (cette dernière année, les émissions d'obligations privées hors chemins de fer et conversions dépassent d'environ 70% leur niveau de 1928.
Or les banques ne perçoivent pas le changement en cours, et continuent de s'adresser au public demandeur d'actions des années antérieures. Elles lui offrent en 1929 des augmentations de capital massives à des prix très élevés (intégrant des primes d'émission considérables, largement contradictoires avec ce désir nouveau de stabilité, cf. Cauboué, 1942). Comme les perspectives de plus-values sont en outre diminuées par la protection des dirigeants résultant des actions à vote plural et des réseaux de participations mis en place durant les années antérieures, le public ne se précipite pas vers les émissions (alors même que les réseaux bancaires sont mobilisés au maximum puisqu'il s'agit souvent de placer leurs propres titres).
Un premier indice de cet échec (relatif) des émissions de 1929 est constitué par la baisse des cours qui démarre en février et ne va pratiquement pas cesser de l'année. Un second est la baisse des transactions, qui dépasse probablement 20% pour les valeurs françaises et certainement davantage pour les actions. Enfin, le gonflement brutal des portefeuilles-titres des banques d'affaires en 1929 puis en 1930 est à la fois le signe de leur dynamisme retrouvé et de l'échec d'une partie des émissions Avec le début de la crise, elles doivent se résoudre à renoncer aux primes d'introduction ou aux plus-values qu'elles attendaient et à placer à tout prix ces titres. Leurs engagements en titres n'en atteignent pas moins un niveau excessif par rapport à leurs fonds propres (malgré les augmentations de capital de 1929), provoquant la chute du Crédit mobilier puis la restructuration de la Banque de l'union parisienne en 1934.
Dans ce marché en recul où les porteurs d'actions se font rares, le début de la crise économique ne peut qu'aggraver la situation. Celle-ci est peu ressentie en Bourse avant fin 1930 : les coulissiers se satisfont début 1930 de la reprise qui s'amorce (constatant que le krach de Wall-Street a eu peu d'effets en France), et un projet de 100 millions de francs pour l'agrandissement de la Bourse de Paris est voté à la mi-1930 par le Conseil municipal de Paris. Ce n'est qu'après cette date que les émissions non seulement d'actions mais également d'obligations privées deviennent très difficiles, ce recul conjoint confirmant d'ailleurs que le report des actions sur les obligations qui avait eu lieu en 1929-30 ne résultait pas de la crise mais bien du changement des préférences des épargnants. Le marché des titres privés s'effondre alors littéralement, bien au delà de ce que laisserait prévoir une crise qui n'atteint pas en France la gravité qu'elle a outre-Atlantique. Les émissions d'actions comme d'obligations baissent de 95% entre leur maximum et leur minimum, les cours chutent de 64% et les transactions totales au parquet de 81%.
La vague de difficultés que connaissent les sociétés cotées contribue à ce repli. Au parquet, les disparitions sont relativement peu nombreuses (une quinzaine par an pendant les années de plus forte crise, de 1931 à 1933), mais les restructurations douloureuses sont légion (la plus célèbre étant celle de Citroën en 1935). Les sociétés cotées subissent 106 réductions de capital entre 1930 et 1936. Les faillites des sociétés inscrites en coulisse sont mal connues, mais, alors que le premier choc est passé, les suspensions de cotation en coulisse sont encore au nombre de 108 en 1934, et de 106 en 1935.
La multiplication des scandales financiers, qui tous témoignent de la capacité de gens sans scrupules à abuser des lacunes de la législation pour déposséder les épargnants ordinaires, contribue aussi à écarter nombre de ceux-ci du marché. Marthe Hanau est arrêtée en décembre 1928, la faillite frauduleuse du coulissier Pacquement a lieu en janvier 1929 : ces deux événements au lendemain de la stabilisation et à la veille du retournement des cours ne sont pas sans conséquence (Marseilhan, 1930, p.83) ; enfin, le scandale Oustric éclate en novembre 1930, celui de l'Aéropostale en mars 1931 et l'affaire Stavisky début 1934 . Le retard avec lequel sont votées les lois destinées à la protection de l'épargne réclamées depuis des années, ne peut que rendre l'épargnant ordinaire soupçonneux envers un marché dont il constate chaque jour davantage les abus (Sauvy, 1984, III, ch.9; Hautcoeur, 1994, ch.5).
Les entreprises elles-mêmes s'écartent du marché. D'une part elles reculent devant les commissions énormes désormais exigées par les banques pour toute émission (Dauphin-Meunier, 1936, p.139). D'autre part, elles retrouvent leurs réticences anciennes à voir leur valeur et donc leur crédit soumis aux variations erratiques d'un marché désormais peu utile (puisque les émissions sont impossibles). Certaines refusent alors les documents nécessaires à la cotation de leurs titres (Michelin donne l'exemple dès avril 1928, Bi-Métal suit en janvier 1930 puis un nombre croissant d'entreprises à mesure que la crise s'approfondit).
Les incitations micro-économiques qui avaient produit la croissance du marché dans les années 1920 disparaissent ainsi les unes après les autres. L'instabilité du système financier apparu alors montre également ses inconvénients. Ainsi de la domination des relations financières à court terme avec l'étranger : quand après 1933, les sorties de capitaux reprennent avec la spéculation contre le franc, l'absence d'une accumulation progressive d'actifs extérieurs à long terme distribués dans de larges couches de la population renforce l'instabilité économique et l'impuissance des gouvernements.
Enfin, dans la situation de monnaie stable et neutre qui perdure jusqu'en 1936, l'antagonisme entre émissions publiques et privées reprend de l'ampleur dès que l'État réapparaît sur le marché financier. Le souvenir des années 1920 est alors au cœur de la lutte déflationniste contre le dérapage des finances publiques et son financement monétaire. À partir de 1932, la dépression entraîne une remontée irrépressible du déficit public, qui provoque une éviction massive des emprunteurs privés et une hausse des taux d'intérêt. Leur conjonction aggrave la crise et entraîne à partir de 1934 une tension sociale et politique qui finit par nuire même au crédit de l'État (Hautcœur, 1993b).
La surimposition de la fin de la crise de stabilisation et du début de la crise économique entraîne donc un blocage du marché. Les épargnants qui avaient permis le développement du marché durant les années 1920 se replient définitivement vers les titres à revenu fixe qui avaient leur préférence avant-guerre. Pire, ils replacent leur argent dans les caisses d'épargne qui retrouvent dans les années 1930 leurs meilleurs heures depuis longtemps, voire thésaurisent des billets de banque ou de l'or comme en plein XIXe siècle (Strohl, 1935).
Conclusion
Nous avons cherché à expliquer la transformation du financement des entreprises privées en la replaçant dans le fonctionnement d'ensemble du marché financier et des les modifications qu'il subit après la guerre. Nous montrons ainsi que le recours massif au marché financier ne résulte pas principalement d'un choix des entreprises, mais à la fois de l'impossibilité où elles se trouvent d'autofinancer leurs investissements, et de la demande importante de titres, en particulier d'actions, à laquelle elles sont confrontées. Le développement massif des émissions ne constitue pourtant pas une évolution durable, mais résulte plutôt d'un certain nombre de changements conjoncturels que connaît le système financier dans les années 1920 en relation étroite avec les ruptures macro-économiques qui résultent de la guerre. Cependant, ces changements ne conduisent pas, à la différence des États-Unis, à la formation d'une bulle spéculative. L'affaissement du marché résulte non de l'éclatement d'une telle bulle, mais de la disparition des facteurs conjoncturels qui avaient fait la prospérité du marché dans les années 1920.
L'image des années 1920 dominante depuis A. Sauvy met un accent trop exclusif sur les aspects réels de la croissance économique et industrielle, en négligeant le prix de l'incertitude liée à l'instabilité très forte de la période, et les chocs massifs sur la répartition du revenu national. L'économie de marché financier qui fonctionnait au XIXe siècle est rompue par l'inflation, qui détruit l'alliance tacite entre épargnants et emprunteurs, par laquelle les premiers acceptaient un rendement faible en échange de sa sécurité (via la stabilité des prix), et entraîne un report des épargnants vers les actions durant les années 1920. Ce transfert massif de capitaux est encouragé par des intermédiaires financiers qui ont perdu à cause de la guerre une grande part de leur capacité d'action directe comme de leurs sources de revenu antérieurs, et auxquels leurs rivalités imposent une conquête rapide de ce nouveau marché qui modifie leurs pratiques et leurs rapports. Ce développement accéléré met le marché des actions au cœur du système financier français pendant quelques années, et permet aux entreprises privées, même de petite taille, d'obtenir un financement abondant qui facilite leur investissement.
Pourtant, le système financier qui en résulte n'est pas stable, car il présente des risques de système et des coûts de transaction très élevés. Le retour à l'étalon-or ne permet pas de le stabiliser. D'une part les mouvements de capitaux à court terme restent toujours aussi massifs et imprévisibles. D'autre part, la stabilisation prend à revers toute l'évolution des années 1920 en permettant aux épargnants de se tourner de nouveau vers les titres à revenu fixe. Le changement affaiblit les intermédiaires dès avant le début de la crise. Celle-ci frappe durement les sociétés, accentue la méfiance des épargnants, qui fuient bientôt hors du marché financier, et contribue au développement d'une hostilité envers les banques, les entreprises et le capitalisme en général que l'on retrouve dans toutes les idéologies qui se développent alors, et dont témoigne la facilité avec laquelle seront acceptées dans une population récemment réputée pour son épargne mobilière, les nationalisations successives de la quasi-totalité des grands secteurs de la cote.
Cet exemple confirme qu'on ne peut pas comprendre le financement de l'économie en se contentant de transposer au niveau de l'ensemble des sociétés des schémas micro-économiques, ni en supposant une procédure neutre d'affectation globale des offres aux besoins de financement. Il faut au contraire analyser en détail les processus d'allocation des capitaux, et les incitations de l'ensemble des intermédiaires concernés, en considérant les différenciations de la demande, de l'offre et de l'intermédiation comme des contraintes (certes partiellement modifiables) sur les directions que peut prendre le financement. Cet article se voulait un exemple de l'utilité d'une telle analyse.
Bibliographie
Baldy E. (1922), Les banques d'affaires en France depuis 1900, thèse, L.G.D.J.
Bouvier J. (1980), "Monnaie et banque d'un après-guerre à l'autre : 1919-1945", in : F. Braudel & E. Labrousse (dir.), Histoire économique et sociale de la France, PUF, IV-2, p.687-725.
Bouvier J. (1984), "The french banks, inflation and the economic crisis, 1919-1939", The journal of european economic history, XIII (2), n° spécial, automne, p.29-80.
Bouvier J., J. Rougerie & P. Verley (1980), "Système bancaire et inflation en France au XXe siècle", Revue internationale d'histoire de la banque, n°19, p.250-319.
Cauboué P. (1942), Banque et problèmes bancaires du temps présent, PUF.
Dauphin-Meunier A. (1936), La banque, 1919-1935, Gallimard.
Denuc J. (1934), "Dividendes, valeurs boursières et taux de capitalisation des valeurs mobilières françaises de 1857 à 1932", Bulletin de la S.G.F., XXIII, juillet, p.691-767.
Ducros B. (1952), L'action des grands marchés financiers sur l'équilibre monétaire, A. Colin.
François-Marsal M. F. (dir.) (1931), Encyclopédie de banque et de Bourse, Crété.
Hautcoeur P.-C. (1993a) "Le financement des entreprises françaises de 1890 à 1939 : une approche micro-économique sur données boursières", Économie et Statistique, n°268-269, p.141-157.
Hautcoeur P.-C. (1993b) "Surévaluation ou crise de confiance ? Hausse des taux d'intérêt et durée de la grande dépression en France", Du franc Poincaré à l'Écu, CHEF, p.97-124.
Hautcoeur P.-C. (1994), Le marché boursier et le financement des entreprises françaises (1890-1939), thèse, Paris I.
Jeanneney J.N. (1981), L'argent caché, Fayard.
Laufenburger H. (1940), Les banques françaises depuis 1914, Sirey.
Lévy-Leboyer, M. (dir.)(1976), La position internationale de la France éd. de l'EHESS.
Marnata F. (1973), La Bourse et le financement des investissements, A. Colin.
Marseilhan P. (1930), La coulisse et sa réorganisation, thèse, Les presses modernes.
Nakayama H. (1982), Le rôle du marché financier parisien, d'après l'exemple des valeurs russes, 1890-1913, thèse, Paris X.
Pose A. (1942), La monnaie et ses institutions, PUF.
Pose A. (1939), "Structures et méthodes bancaires", in Rist & Pirou (1939), p.329-55.
Rebotier M. (1935), Les participations bancaires à l'industrie, Sirey.
Rist Ch. & G. Pirou (dir.) (1939), "De la France d'avant-guerre à la France d'aujourd'hui", numéro spécial de la Revue d'économie politique.
Rist Ch. & P. Schwob (1939), "La balance des paiements", in:Rist & Pirou (1939), p.228-50.
Sauvy A. (1984), Histoire économique de la France entre les deux guerres, Economica.
Strohl P. (1935), "La circulation des billets de 1000 et de 500 francs depuis la stabilisation du franc", Revue politique et parlementaire, CLXV, décembre, p.417-434.
Villa P. (1993), Une analyse macroéconomique
de l'économie française au XXe siècle,
CNRS.
Graphique 1 : parts des différents émetteurs sur le marché, 1919-1936
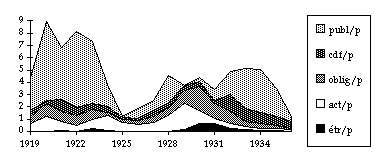
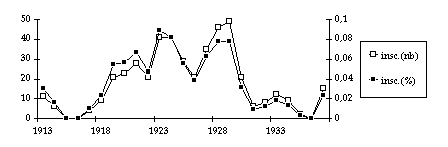
|
1923
|
1924
|
1925
|
1926
|
1927
|
1928
|
||
| Nombre d'adhérents |
134
|
134
|
138
|
142
|
149
|
149
|
|
| Nouveaux adhérents |
8
|
11
|
11
|
17
|
11
|
||
| Livraisons pour compensation |
5,59
|
9,35
|
12,6
|
23,08
|
13,57
|
23,5
|
|
| Id. en francs 1913 |
1,68
|
2,46
|
3,10
|
4,35
|
2,45
|
4,26
|
|
| Produits de la cote |
0,72
|
0,97
|
1,11
|
1,9
|
2,82
|
|
|
|
|
|||
| Flux d'inscriptions | |||||
| Cote officielle |
|
|
|
||
| Cote officielle 2 |
|
|
|
||
| Coulisse |
|
|
|
||
| Renouvellement = flux/stock initial | |||||
| Cote officielle 2 |
|
|
|
||
| Coulisse |
|
|
|
||
| Disparitions (minimum) | |||||
| Cote officielle 2 |
|
|
|
||
| Coulisse |
|
|
|
||
| Taux de disparition = disparitions/stock initial | |||||
| Cote officielle 2 |
|
|
|
||
| Coulisse |
|
|
|
||